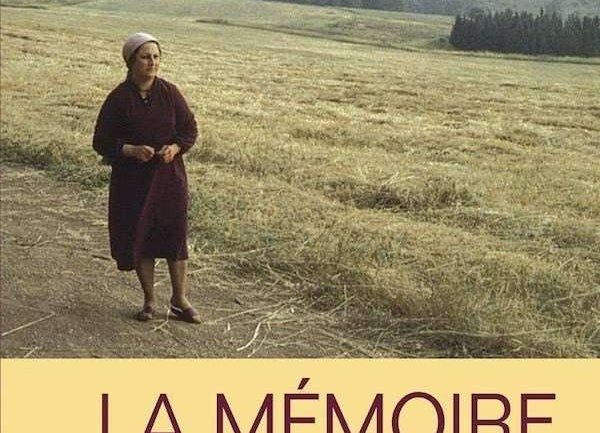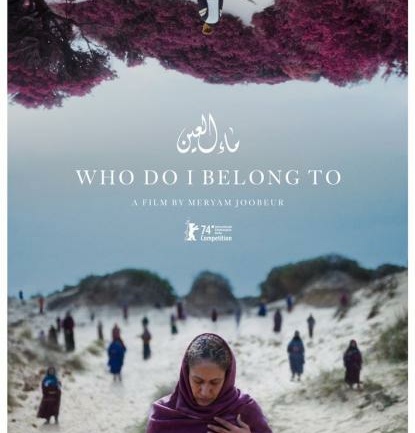373, Pasteur Street choisit de contempler le monde depuis un point fixe. Le film reste
immobile, mais est traversé de mille mouvements. Mohamed Ismaël Louati y transforme un
simple balcon beyrouthin en observatoire du réel. Tout y est cadré depuis un seul lieu, comme
si l’histoire d’un pays et celle d’un amour disparu pouvaient se condenser dans la vue d’une
rue.
Il y a bien une histoire autour du 373, rue Pasteur à Beyrouth. C’est l’adresse du Beirut Art
Residency, un espace de diffusion pour l’art contemporain. L’une de ses micro-initiatives, La
Vitrine, est un petit atelier/expo vitré donnant directement sur le trottoir. La rue Pasteur, dans
le quartier de Gemmayzeh, n’est pas récente : elle faisait partie des anciennes voies de
Beyrouth, reliant la vieille ville à la zone de quarantaine du XIXᵉ siècle. Elle porte une forte
empreinte historique et architecturale. Plus récemment, après l’explosion de 2020, elle a été
le théâtre d’installations commémoratives et de projets urbains. Le Beirut Art Residency et
La Vitrine donnent ainsi au 373 une visibilité culturelle tangible et en font un point de départ
concret pour saisir son histoire.
C’est là qu’Ismaël ancre son regard et installe sa caméra. Le court métrage se déploie comme
une lettre filmée, adressée par un homme à la femme qu’il a perdue. Cette correspondance,
lue en voix off, donne au film sa respiration. Le texte, intime et poétique, se déploie sur des
images du quotidien : les passants, les travailleurs, les façades écaillées et les gestes répétitifs
d’un quartier. Rien d’extraordinaire, sinon le regard. La caméra, obstinée, s’accroche aux
détails ; elle observe et attend.
Cette distance crée un écho entre le personnel et le collectif. Le deuil amoureux devient la
métaphore d’un autre deuil : celui du Liban, pays fissuré mais toujours vivant. À travers la
perte d’un être aimé, c’est la perte d’une ville qu'Ismaël met en scène ; à travers le balcon,
c’est tout un territoire qui tente de se dire.
En choisissant la forme de l’essai filmique, Ismaël s’inscrit dans une tradition où le cinéma
devient un espace de pensée. À la manière de Chris Marker ou d’Harun Farocki, il mêle
fiction, documentaire et méditation poétique. Il refuse la frontière entre réel et souvenir. Cet
essai filmique propose une pensée sensible, un dialogue entre l’image et la voix, qui hante les
plans et les réchauffe, sans rien expliquer.
Le dispositif est simple, presque ascétique : une seule caméra, un seul point de vue, un texte
lu. Mais cette simplicité est précisément ce qui donne au film sa puissance : le cadre devient
cage et refuge, la répétition devient mémoire, la monotonie devient résistance. En filmant le
monde sans le quitter, Ismaël signe un cinéma de l’attente et du deuil, où l’observation du
quotidien devient une prière silencieuse pour ce qui reste. Abbas Kiarostami avait porté un
regard similaire dans son film Five Dedicated to Ozu (2023), explorant le temps et le
mouvement par le plan fixe.
Mais un film sans intrigue, sans déplacement, sans drame visible : est-ce encore du cinéma ?
Oui. Peut-être même le cinéma dans sa forme la plus pure. Car ce que Ismaël met en œuvre,
c’est précisément le cœur du langage cinématographique : le temps, la lumière, le regard. Ce
cinéma-là regarde et écoute le silence autour de lui. En filmant depuis un balcon, le
réalisateur se relie au monde. L’immobilité se transforme en mouvement intérieur. L’attente
devient récit.
Ce court métrage nous rappelle que le cinéma peut encore être un geste fragile et sincère :
celui d’un regard qui persiste, malgré tout, à croire en la beauté du réel.
Fedoua Medallel